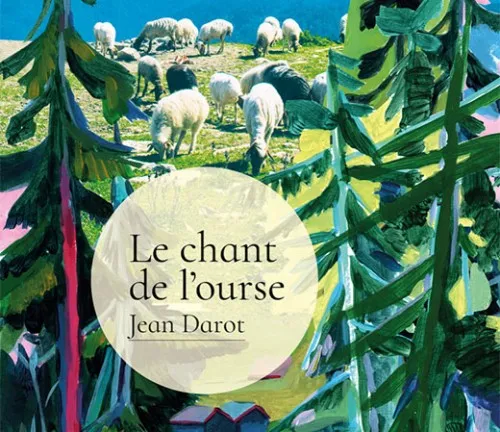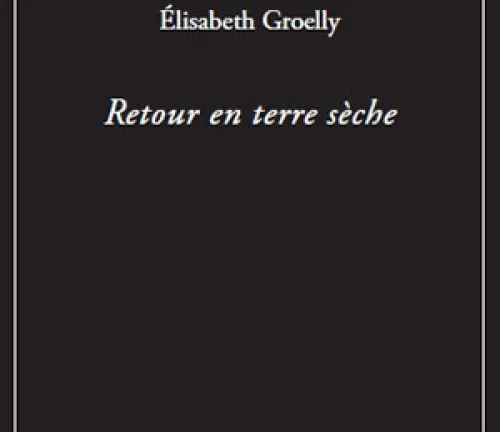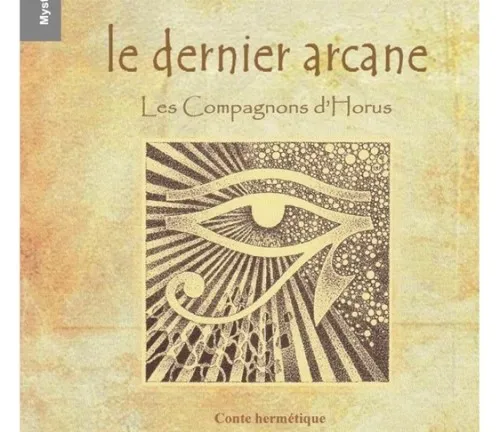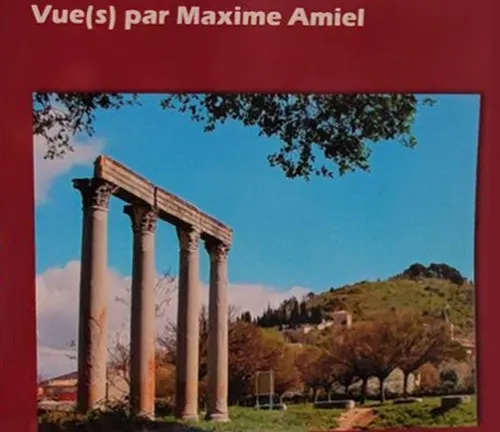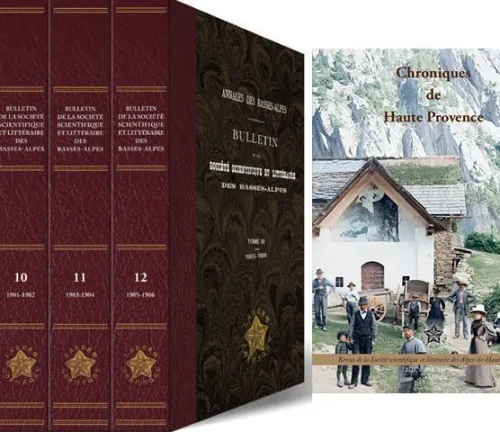L'association des Amis de Jean Giono a lancé son premier concours de nouvelles Jean Giono en avril 2024.
Le texte intitulé Le parfum de Durance a été primé par le jury du concours de nouvelle organisé par l’Association des Amis de Jean Giono dans le cadre des Rencontres Giono qui se sont tenues à Manosque du 1er au 4 août 2024.
Le lauréat, Rémy Hatier, a obtenu le 1er prix et sa nouvelle sera publiée dans la Revue Giono n°17 à paraître en juin 2025.
Nous publions ce texte avec l'aimable autorisation de Christian Morzewski, Président de l’Association des Amis de Jean Giono.
Renseignements sur le concours sur le site internet de l’association : lesamisdejeangiono.fr
Le texte devait poursuivre un incipit extrait de Manosque-des-Plateaux de Jean Giono.
Le Parfum de Durance de Rémy Hatier
— La Durance a mordu de ses eaux amères la grande montagne des Alpes : elle a scié les granits, elle a désagrégé les grès ; elle a fondu les terres, emporté les arbres, les prés, les débris des ponts, une ferme ou deux avec les petits au berceau. De tout ça elle a fait son lit : la plaine. Elle l’a tassée durement en la battant de sa queue grise. La terre a peur…
Judith scanda cette dernière phrase, la laissant s’envoler, tel un vautour fauve du Verdon qui, éternel immobile scrutant une proie, reste en suspens dans les courants. Seul le bruissement de l’eau accentuait le silence, remplissait l’espace.
— Relis-moi ce passage s’il te plaît, Judith. C’est étrange.
— Étrange ?
— Oui ; personnifier ainsi la rivière, donner vie à la terre…Elle a peur…Redis-moi cette simple et dernière phrase…Elle porte tout en elle ; faire plus simple et plus puissant à la fois me paraît impossible, à moins d’être magicien et d’inventer de nouveaux mots.
— C’est bien pour ça que nous sommes ici, Pallas ! Pas vraiment pour inventer de nouveaux mots, mais pour libérer l’imaginaire et l’inscrire dans le cours de la rivière ; allez, au travail !
Judith se saisit d’un galet, gris et lisse, qui bloqua le livre qu’elle venait de poser sur l’envers, lui donnant ainsi une forme d’accent circonflexe ; Pallas rêvassait, comme à son habitude, se laissant bercer par la tiédeur feutrée de l’instant et le soleil qui caressait sa nuque. Délaissant le vautour qui ne s’épuiserait jamais, car loin de lutter contre la nature il en faisait son alliée, elle détourna le regard vers sa sœur.
— Ton idée de venir au bord de la Durance pour trouver l’inspiration est tout simplement lumineuse.
— Oui ; peut-être. Mais il faut avancer, s’il te plaît ! Ça ne va pas s’écrire tout seul.
— Tu ne trouves pas ça un peu prétentieux ?
— Quoi ?
— Eh bien, prendre un texte de Jean Giono et en écrire la suite.
— C’est un exercice, Pallas ; je pense que notre professeure de Français veut nous apprendre à regarder le monde, la nature, les hommes aussi peut-être, avec des yeux différents, nouveaux…C’est bien toi qui as dit, il y a une minute à peine, que tu trouvais étrange la façon dont Giono personnifiait la nature ? Voilà une idée ! Personnifions la terre, l’eau, les arbres, le ciel…Créons de nouveaux personnages !
— On n’y arrivera jamais.
— Essayons tout de même ! Quand tu repenses à ce début de texte, comment imagines-tu la Durance ?
Pallas prit quelques secondes de réflexion, les yeux mi-clos, la tête rejetée en arrière.
— Non…Toi d’abord…Je ne suis pas encore imprégnée de cet endroit ; il me surprend.
— Tu peux m’en dire plus ?
— Judith, nous voilà au bord de la rivière ; c’est le cadre. Tu viens de me lire, d’une façon magistrale, le texte qui, au son de ta voix, s’est fait tableau de maître…Mais ce n’est pas ce que j’ai sous les yeux. Je ne vois que de maigres filets d’eau, semblables aux membres décharnés d’une paysanne épuisée que le soleil va occire ; toi, que vois-tu ? Dis-moi ta Durance, je te dirai la mienne ensuite, si je la découvre.
Le soleil de cet après-midi de mai se réclamait d’un solstice victorieux ; flèches aux pointes acérées, ses rayons avaient martyrisé Saint Pancrace. Les deux sœurs s’étaient rendues sur une berge de la Durance, non loin de Manosque ; sans se mouiller plus haut que le mollet, elles avaient traversé un doigt de la rivière et rejoint un ilot de fraîcheur où trois jeunes peupliers pactisaient avec le sol : cendre évanescente faite de poussières des schistes de l’Ubaye, la terre accueillait leurs racines qui en retour, telles des mains secourables, se feraient rempart lors des crues automnales. De ces arbres en sursis, les ombres irradiées s’agrippaient pour ne pas disparaître. Judith suivait du regard un couple d’hirondelles, virevoltant dans la fraîcheur, au ras de l’eau. Moins habile que sa sœur pour le maniement des mots, elle était pudique et hésitait à se lancer.
— Ce matin, alors que le soleil n’avait pas encore franchi la Serre du Mont-Denier, je suis allée sur notre terrasse…Et j’ai vu la vallée, comme jamais je ne l’avais vue.
Suspendue aux lèvres de sa sœur, Pallas savait que cette porte, venant de s’ouvrir, allait offrir un horizon grandiose.
— La Durance avait disparu ; seul restait un chemin moutonneux en fond de vallée, courant jusqu’à Saint-Paul…Elle se cachait sous les nuages. J’ai alors imaginé l’eau pure et froide arrivant de l’Alpe ; elle porte en elle les bêlements des troupeaux, les tintements dissonants des cloches, les aboiements des chiens, les cris joyeux des enfants ; elle a étanché la soif du randonneur, de la biche et de son faon, elle a rafraîchi la nuque du berger…Elle ne fait que de belles choses, n’a que de belles histoires à raconter. Alors, pourquoi se cache-t-elle sous son habit de coton ? J’ai fait quelques recherches et j’ai compris : la Durance a honte, et ne se reconnaît plus dans ces jours d’autrefois quand, jeune fille sauvage, elle battait la terre de sa queue grise.
— Je t’entends lyrique, ma sœur, ce qui n’est pas dans tes habitudes. Il va donc falloir que tu m’en dises plus.
Judith reprit le livre et s’intéressa à la quatrième de couverture.
— Jean Giono a écrit ce texte en 1930…La Durance, sauvage, cruelle, meurtrière consommée qu’il y décrit, n’existe plus.
— Meurtrière consommée ? Tu ne mâches pas tes mots !
— C’est que, vois-tu, j’ai découvert, en enquêtant sur elle, un fait troublant.
— Un suspense digne d’un thriller ! Où tout cela va-t-il nous mener ? On devait continuer à personnifier la rivière mais là, je tremble.
— Je suis remontée à sa source, au sommet des Anges. De là, la Durance jaillit des prés et s’élance pour rejoindre, quelques kilomètres plus bas, une autre rivière, la Clarée…
Impatiente, Pallas coupa la parole à sa sœur.
— Rien de bien excitant jusque-là.
— Attends ! Les deux rivières scellent leur union au pont des amoureux.
— Charmant…et en avance sur l’époque !
— Pallas ! Sois sérieuse et arrête de m’interrompre ! C’est là, au pont des amoureux, que la Durance va commettre son forfait : elle tue la Clarée.
— Et alors ? C’est la règle à chaque confluence, il me semble.
— La Clarée est, à cet endroit, une rivière déjà plus longue, plus vigoureuse et exubérante que la Durance ; celle qui s’écoule en aval du pont des amoureux ne peut être la Durance, mais la Clarée.
— Usurpation d’identité ?
— Non, meurtre ! La Durance est née violente, sauvage, brutale. C’est bien celle que Giono décrit ! La terre et les hommes ont peur de la sournoise, celle dont la violence s’abat sans sommation.
Pallas se prit alors au jeu.
— Vous avez d’autres preuves, Madame la Commissaire ?
— Prends une carte : regarde le cours de la rivière. Non, ne regarde pas, observe.
— Je n’ai pas de carte.
— Je l’ai fait pour toi, ce matin ; tu pourras vérifier.
— Qu’as-tu découvert d’autre ?
— Tu suivras le cours de la rivière ; elle ne traverse aucun village. Tu entends bien, Pallas, aucun village n’a pu se résoudre à s’établir autour d’elle pour profiter des bienfaits d’une eau abondante et proche. Bien au contraire, terrorisés par la froide cruauté de la bête, villes et villages, à l’exception de Briançon qui la voit passer, encore juvénile mais souriante de son forfait récent, tous se sont réfugiés sur des promontoires ou sur une seule rive, se tenant ainsi éloignés…Oui, je le redis, Giono a raison, qui écrit que la terre a peur…Je rajoute les hommes…Il ne l’a pas écrit, parce qu’à cette époque et en ce lieu, terre et homme ne faisaient qu’un.
Judith resta silencieuse quelques instants, comme un procureur après avoir posé ses derniers mots pour que l’auditoire imagine le sifflement du couperet qui s’abat.
— Quel est le verdict ?
— Coupable, Pallas…La bête est domptée. Aujourd’hui, la retenue de Serre-Ponçon est une cage dorée qui muselle l’animal féroce, le tient en laisse. Sur le reste de son parcours, les hommes vont se venger, prélevant et pompant ses ultimes forces ; ici, on ouvre un canal pour irriguer les champs et les vergers, là on dérive une partie du flux pour faire encore et toujours plus d’électricité, là enfin, tel le vampire, on aspire goulûment pour étancher la soif inextinguible des métropoles côtières…Et voilà que devant nous, la bête est affalée, exsangue…Elle rampe à nos pieds et se cache, honteuse de sa faiblesse…Voilà pourquoi tu ne la reconnais pas dans le texte.
— Belle démonstration.
— Merci. À toi maintenant.
Pallas sembla réfléchir quelques instants ; elle gardait les yeux rivés dans le maigre courant.
— Je suis d’accord avec toi…C’est une guerrière…Cruelle, sans pitié…Une ogresse…Attila faite femme…Non, je crois que j’ai mieux !
— Ah ?
— Athéna. Pallas Athéna, déesse de la Guerre, des Armes mais aussi de la Sagesse, de la Pensée…Oui, tout ça, c’est notre Durance…Guerrière fougueuse dans ses crues, mère aimante dans la plaine qu’elle irrigue, permettant ainsi aux hommes de vivre, de penser, d’aimer…Seul un mot me gêne.
— Qui est ?
— Mère…C’est que, la Durance, j’ai soudainement envie de la mettre au masculin, vois-tu. Pourquoi se laisser enfermer dans cette habitude de la langue française de vouloir attribuer un genre à chaque chose ? Car si les aléas des secousses telluriques avaient modelé les reliefs avec une autre main, alors la Durance irait peut-être jusqu’à la mer, seule…et ainsi serait fleuve !
Judith était enchantée, une nouvelle fois subjuguée par la capacité qu’avait l’esprit de sa sœur à s’échapper par mille chemins de traverse ; en l’entraînant jusqu’au bord de la rivière, plutôt que de rester dans une chambre derrière un bureau, elle avait atteint son but : libérer l’imagination foisonnante et souvent délirante de Pallas. À Pallas, le bouillonnement d’idées ; à elle incomberait le fastidieux travail de tout remettre en ordre.
— Je ne te comprends pas. Tu m’expliques ?
— Suis-moi ; je suis Durance. À Vinon, je prends le Verdon par la main et à Saint-Paul, fort de cet ultime secours, je bouscule les montagnes de Vautubière, des Ubacs et la colline de Saint Pierre. Je ne m’enfuis plus vers le couchant, tournant dédaigneusement le dos à l’Alpe, ma génitrice. Je file tout droit ! Et s’il le faut, plutôt que de la contourner, je gomme la Sainte-Victoire ; je joue Giono contre Cézanne…Le voilà perdu, le pauvre ! Le pauvre ? Non, il ne le sait pas encore, mais il est sauvé ! Son horizon ne sera plus barré par la pyramide bleue ; il ne m’en voudra pas. À Manosque, il peindra, dans toute sa voluptueuse et gourmande rondeur, le sein qu’est la colline du Mont d’Or ; puis il ira jusqu’au Contadour et en chemin, fera de la montagne de Lure l’unique modèle de l’ovale parfait, celui de la hanche si désirable d’une jeune Provençale callipyge. Pardon, je m’égare…Tu es avec moi, Judith ?
— Oui, sœurette, je suis là.
— Alors, suis-moi encore, suis-moi toujours, je redessine la ligne de plus grande pente, la trace invisible du destin de l’eau, le chemin obscur du destin des hommes…Devant moi, se dresse un ultime obstacle : le massif de l’Étoile. Je ne le touche pas, je l’effleure.
— Pourquoi cette mansuétude soudaine ?
— C’est le gardien du phare, Judith ; il surplombe la mer, il veille et nous protège des tempêtes. Je le contourne pour enfin me couler aux pieds du rocher des Pennes-Mirabeau ; la pente agonise lentement, se meurt…Là, avant de m’abandonner à l’immensité salée, je nourris l’étang de Berre…Voilà la destinée du Fleuve Durance !
— Je ne te savais pas si calée en géographie, ma chère sœur.
— Ce n’est pas de la Géographie, Judith ; c’est de la Provence.
Judith acquiesça d’un léger mouvement de tête.
— Bon, d’accord, j’ai compris : faisons de la Durance, pardon, du fleuve Durance, un homme, un père.
— J’aime à voir les choses ainsi : Durance est mâle et ne bat plus la terre. Non ! Il la caresse, il l’aime…Il l’enserre tendrement, mais virilement, de tous ces bras vigoureux que sont ses affluents…Clarée, Guil, Ubaye, Bléone, Asse, Largue, Verdon…Oui, il la plaque contre lui et lui fait l’amour, passionnément…Si j’osais…
— Ose !
— Il s’enfonce en elle, lentement, voluptueusement et la féconde ; les nappes phréatiques se font ventres, l’eau redevient ce liquide vivant qui protège et nourrit. Elle ne se dresse plus en vagues, elle n’est plus cette lame qui tranche aveuglement arbres, maisons…berceaux.
Essoufflée au bout de sa tirade, Pallas ne put retenir la larme que déclencha en elle l’image d’un lit d’enfant, englouti par des flots boueux.
— Fleuve et terre sont amants ; leur amour est fusionnel et, je rejoins Giono, cet amour ne peut qu’engendrer les plus terribles déchirements. Judith, voilà Durance, telle que je la vois.
Judith avait maintenant le regard rivé dans l’azur.
— C’est un beau voyage, un beau rêve au fil de l’eau que tu m’as offert, Pallas. Il nous reste à écrire tout ça.
— Non, Judith, s’il te plaît, n’écrivons rien ; n’emprisonnons pas nos paroles sur du papier. Laissons plutôt nos rêves s’envoler. Mais pour que cela se réalise, il nous manque encore une dimension.
— Laquelle ?
— L’odeur, le parfum, la fragrance ; appelle-la comme tu veux, mais elle est nécessaire pour que nos mots voyagent…Et cette odeur, c’est celle de Durance.
Judith restait immobile, ne sachant plus vraiment où sa soeur l’amenait. Pallas souleva alors le galet rond et lisse qui bloquait le livre ; elle l’ouvrit et lut.
— La Durance est dans la plaine comme une branche de figuier. Souple, en bois gris, elle est là, sur les prés et les labours, tressée autour des islettes blanches. Elle a cette odeur du figuier : l’odeur de lait amer et de verdure.
En savoir plus
- Téléchargez le texte Le Parfum de Durance.
- Renseignements sur le concours sur le site internet de l’association : lesamisdejeangiono.fr
- Les livres de Rémy Hatier présentés sur le blog